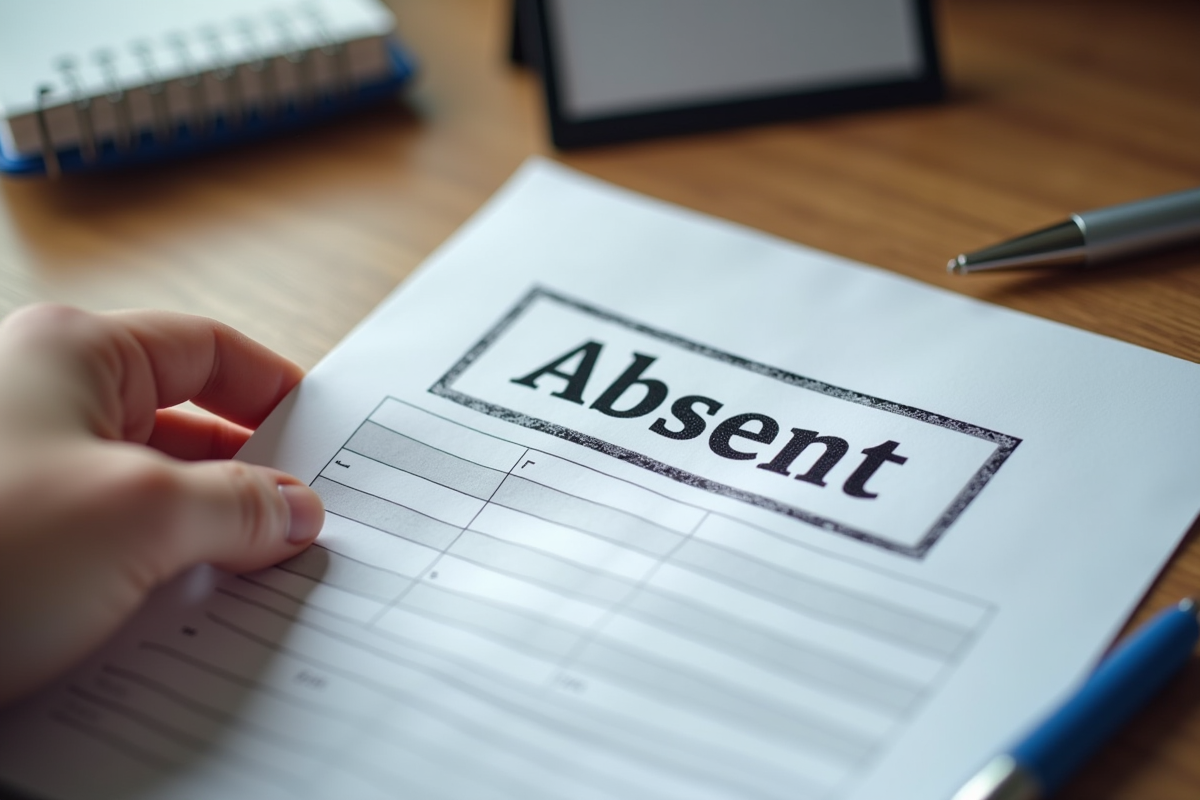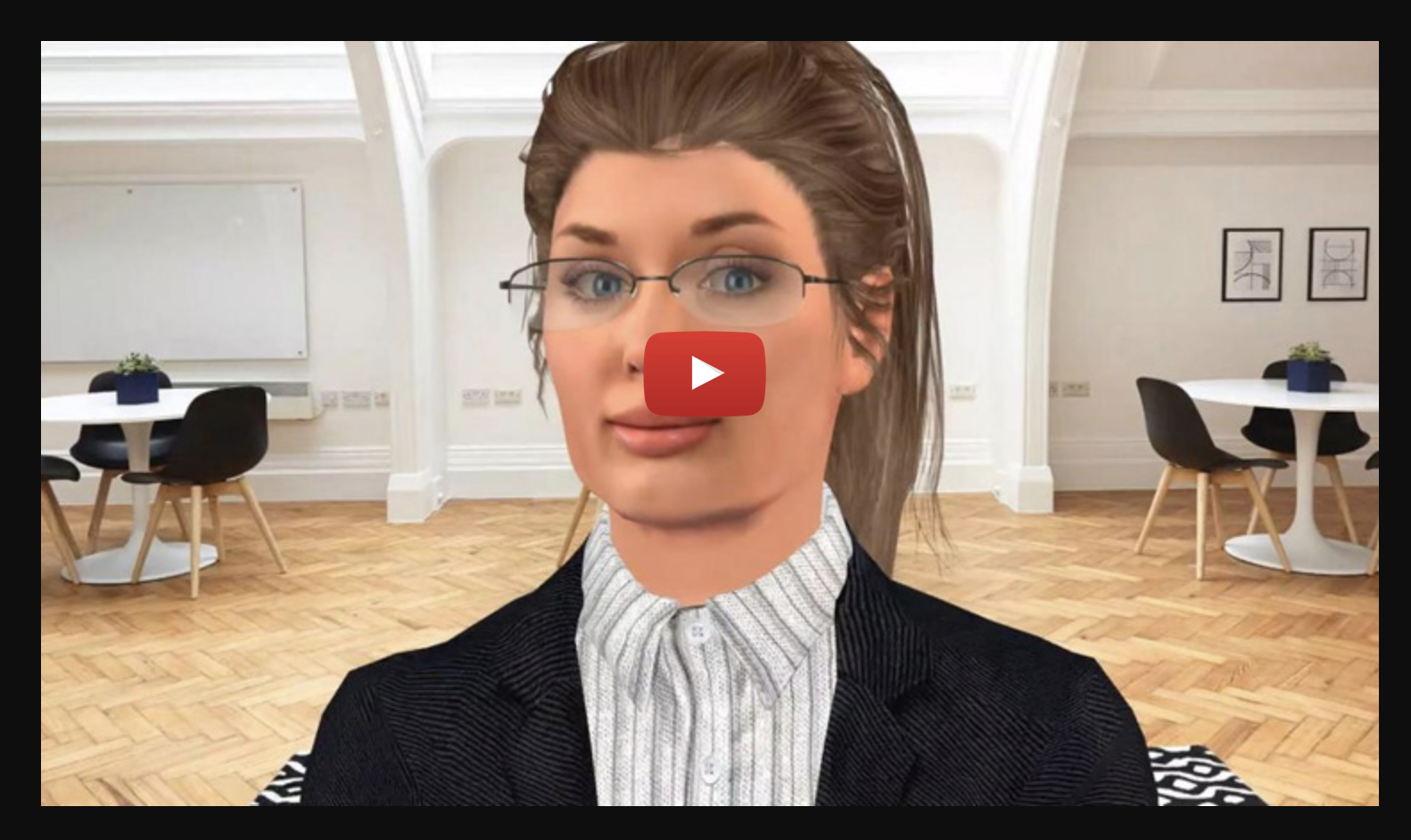Un chiffre, une règle, et des conséquences qui ne laissent personne indifférent : depuis 2018, tout agent public en arrêt maladie voit sa rémunération suspendue le premier jour d’absence, sauf exceptions précises prévues par la loi. Cette règle ne s’applique pas dans certains cas, notamment lors d’un congé pour maladie professionnelle ou d’un arrêt lié à une grossesse pathologique.
Le dispositif varie selon le statut, le type de contrat et la cause de l’arrêt. Les modalités d’application soulèvent régulièrement des interrogations sur les droits des agents et les démarches à suivre.
Le jour de carence dans la fonction publique : définition et cadre légal
Le jour de carence frappe tous les agents de la fonction publique dès le 1er janvier 2018, à l’occasion d’un arrêt maladie. Concrètement, qu’il s’agisse d’un fonctionnaire ou d’un contractuel, le premier jour d’absence n’est pas payé lors d’un premier arrêt. Ce principe, inscrit dans le projet de loi de finances 2018 puis entériné par la loi de finances de la même année, poursuit un objectif bien affiché : rapprocher la fonction publique du régime du secteur privé.
Tous les versants publics sont concernés : État, collectivités territoriales, hôpitaux. Le délai de carence s’applique à chaque nouvel arrêt, même si celui-ci intervient après une reprise, fût-elle brève. Toutefois, certains cas échappent à la règle : maladie professionnelle, accident de service, maternité, ou affection de longue durée. Les agents en invalidité temporaire imputable au service sont également protégés de cette retenue.
Les textes fondateurs
Pour comprendre le socle légal du dispositif, voici les textes de référence :
- Article 115 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (loi de finances 2018)
- Décret n°2018-502 du 20 juin 2018, fixant les modalités d’application
La mesure, portée à l’Assemblée nationale par Guillaume Kasbarian, visait à endiguer l’absentéisme dans la fonction publique et à maîtriser la dépense publique. L’Insee a souligné la progression des arrêts maladie dans le secteur public, un constat qui a pesé dans la balance. Le dispositif cherche à responsabiliser les agents, tout en préservant les garanties pour les situations médicales les plus lourdes. L’équilibre se joue entre équité et exigence de service public : la journée de carence cristallise ce compromis.
Quels agents sont concernés et dans quelles situations s’applique-t-il ?
Dans la fonction publique, la règle du jour de carence touche la grande majorité des agents, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels. Dès le premier arrêt maladie pour maladie ordinaire, le principe est sans ambiguïté : la première journée d’absence n’est pas payée. Ministères, collectivités, établissements hospitaliers, la mesure ne fait pas de distinction.
Mais la mosaïque des situations dans le secteur public implique des exceptions. Le congé maladie ordinaire entraîne systématiquement la retenue du jour de carence, contrairement aux arrêts pour affection de longue durée (ALD), accident de service ou maladie professionnelle : dans ces cas, la protection statutaire l’emporte.
Pour mémoire, voici les profils concernés ou exclus par le dispositif :
- Agents titulaires (fonctionnaires d’État, territoriaux, hospitaliers)
- Agents contractuels de droit public
- Exclusion pour congé maternité, paternité, adoption et invalidité temporaire imputable au service
Chaque nouveau congé maladie, même très rapproché, rouvre le compteur : une reprise, même brève, déclenche à nouveau le mécanisme. Cette rigueur distingue la gestion publique de celle du secteur privé, où le délai de carence, fixé à trois jours, n’est pas systématiquement appliqué à chaque arrêt. Les agents doivent donc mesurer l’impact financier d’une absence, en particulier si les arrêts se succèdent.
Comprendre l’impact du jour de carence sur la rémunération et les droits des fonctionnaires
Le jour de carence se traduit par une réduction immédiate du traitement indiciaire pour les agents publics. Contrairement au secteur privé où la retenue s’étale sur trois jours, la fonction publique ne prélève qu’une seule journée lors d’un nouvel arrêt maladie. Cette retenue s’effectue sur le traitement brut, sans distinction de grade ou d’ancienneté, et se répercute sur la fiche de paie dès le mois suivant.
L’incidence ne se limite pas au traitement de base. Les primes et indemnités liées à la présence effective, comme la NBI (nouvelle bonification indiciaire) ou le supplément familial de traitement (SFT), sont aussi concernées. Certaines primes, selon les textes propres à chaque administration, peuvent toutefois être maintenues.
Voici les principaux éléments impactés lors de l’application du jour de carence :
- Le traitement indiciaire subit une retenue équivalente à un trentième pour la journée d’absence.
- Les indemnités journalières de l’État ne couvrent pas le premier jour d’arrêt.
- La NBI et le SFT peuvent être ajustés selon le statut de l’agent.
Les droits à congés ne sont pas touchés par la retenue, mais la multiplication des absences peut peser sur la gestion des équipes. La règle reste identique, quel que soit le nombre d’arrêts successifs, dès lors qu’ils sont séparés par une reprise. Plusieurs avis de la DGAFP valident ce fonctionnement, qui distingue la gestion des arrêts maladie dans la fonction publique de celle du secteur privé.
Conseils pratiques pour mieux gérer un arrêt maladie et anticiper le jour de carence
On ne choisit pas de tomber malade, mais il est possible d’anticiper les effets du jour de carence sur son budget. Un réflexe à adopter : contacter le service des ressources humaines dès la déclaration d’un congé maladie. Cette démarche permet d’obtenir des réponses sur la rémunération, les primes concernées et les solutions d’accompagnement parfois disponibles.
Voici quelques conseils pour traverser cette période avec plus de sérénité :
- Conservez systématiquement une copie de votre arrêt de travail et transmettez-le rapidement, afin d’éviter tout retard de paiement.
- Examinez chaque mois votre fiche de paie : la retenue liée au jour de carence doit y figurer en toute transparence.
- Renseignez-vous auprès de votre mutuelle : certaines proposent un complément pour compenser la journée non rémunérée.
La vigilance est de mise lors de successions d’arrêts maladie. Un nouveau jour de carence ne s’applique qu’en cas de reprise effective entre deux arrêts. Cette règle vaut partout, que vous releviez de la fonction publique territoriale ou hospitalière. Pensez également à vérifier l’impact sur vos droits à l’avancement et sur le calcul de certaines indemnités.
Maintenir un dialogue avec votre médecin traitant, anticiper la durée de l’indisponibilité et prévenir l’employeur en cas de prolongation facilitent la gestion administrative. Une bonne coordination entre agent, administration et professionnels de santé limite les malentendus, en particulier lors d’un premier arrêt maladie. Il ne faut pas négliger les dispositifs d’accompagnement social, qui diffèrent selon les collectivités et établissements.
Le jour de carence n’est pas qu’une ligne sur la fiche de paie : c’est un signal qui invite chaque agent à repenser la gestion de ses absences, à s’informer et à anticiper. Au fil des années, il s’est imposé comme un marqueur du dialogue entre responsabilité individuelle et solidarité collective, sur le fil tendu du service public.